Note de lecture publiée dans L’Ours n°535, novembre-décembre 2024.
François Dubet et Najat Vallaud-Belkacem, Le Ghetto scolaire. Pour en finir avec le séparatisme, Seuil, « la république des idées », mars 2024, 144 p., 12,90€.
Alors même que des publications récentes, jusqu’à celle de la Cour des comptes, ont remis en évidence les inégalités scolaires et une ségrégation qu’illustrent les IPS (indices de positionnement social) et que, en regard des « ghettos scolaires », le séparatisme des plus aisés a défrayé la chronique après les impairs d’une éphémère ministre de l’Éducation nationale, soulignons l’intérêt de cette publication d’un format accessible, mais à la fois documentée et précisément sourcée, que l’on doit au binôme constitué par un sociologue, spécialiste reconnu des inégalités éducatives, et une ancienne ministre de l’Éducation nationale, résolument orientée à gauche.
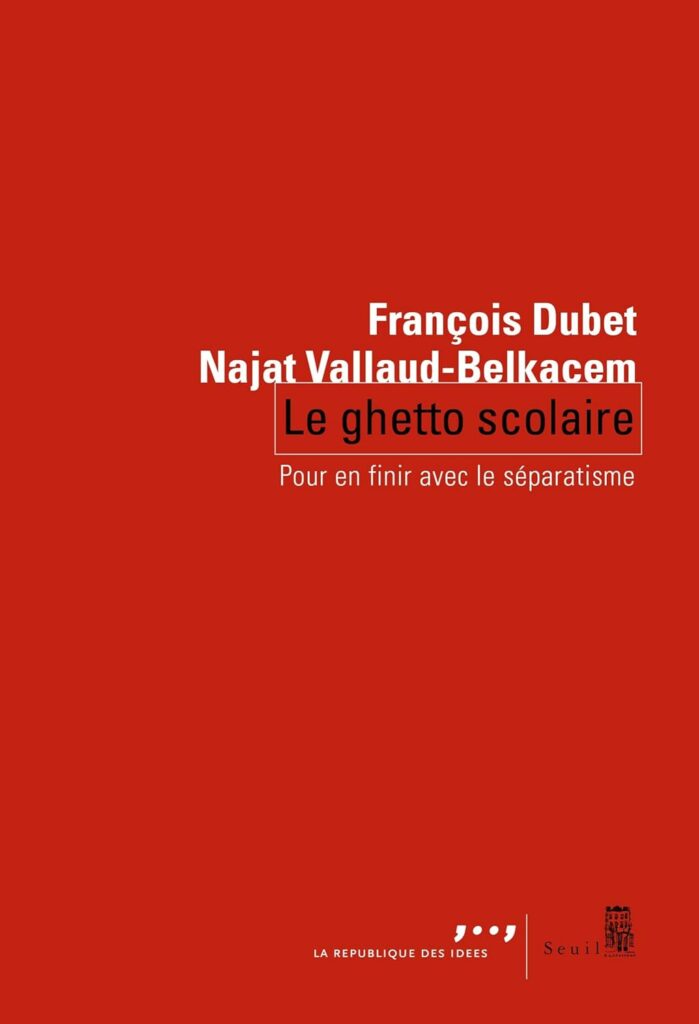
Questionnements
Il ne s’agit pas d’un ouvrage de circonstance après les errances éducatives de la macronie, d’un système Blanquer à l’évidence à bout de souffle auquel a succédé d’abord un très décevant Pap Ndiaye (fallait-il en espérer quelque chose tant l’exercice était biaisé ?), puis une Amélie Oudéa-Castera dont les maladresses auront permis de braquer les projecteurs médiatiques sur le très élitiste et très réactionnaire collège Stanislas.
François Dubet et Najat Vallaud-Belkacem nous offrent un travail de fond, raisonné, allant au-delà des présupposés « de gauche » en évoquant toutes les questions – même celles qui gêneraient –, toutes les approches – même celles qui pourraient sembler contre-intuitives, comme la question de la refonte de la sectorisation scolaire pour les familles populaires qui ne va pas forcément de soi. L’analyse des paradoxes, des ambivalences des différents acteurs et de leurs stratégies n’est jamais absente d’une réflexion qui entend ne laisser aucun élément dans l’ombre.
Le livre est organisé en six chapitres qui forment des paires pour trois grandes parties de fait: l’analyse (mixité et ségrégations, territoires et acteurs) ; les expérimentations engagées en 2015 et leurs suites (retour sur expérience, effets constatés) ; la dimension nationale de l’action (politique nationale, École et société)
Si l’ouvrage n’est pas un catalogue de poncifs, il n’y a pourtant aucune hésitation sur le message de fond: celui d’un refus d’un séparatisme scolaire qui aggrave les inégalités sociales de départ, mais, surtout, a des conséquences sur l’inefficacité du système éducatif. Sur les logiques de « ghetto », les auteurs commencent par poser la question des émeutes urbaines qui ont vu des dizaines d’écoles vandalisées et une vingtaine d’entre elles détruites. Et de préciser: « Les vaincus du jeu social en veulent à l’École parce qu’ils sont aussi les perdants de la compétition scolaire […] qui fixe leurs destins, qui les assigne à résidence sociale » (p.8). Mais les auteurs rappellent aussi qu’il y a parfois des logiques d’établissement (classes à options débouchant sur des classes de niveau aux effets délétères). Or, soulignent-ils, on ne peut oublier que « 70% des enfants défavorisés ne sont pas scolarisés dans l’éducation prioritaire » (p.100), même si elle concentre et cumule les difficultés.
Une approche par le local, la nécessité d’une politique nationale forte
Mais c’est avec raison que les auteurs rappellent que « ce n’est pas la carte scolaire qui changera le territoire. C’est des territoires et de l’innovation collective que viendront les solutions » (p.54). De fait, le développement sur les expérimentations montre combien chaque situation est unique en son genre et comment les solutions, pour être mises en place, nécessitent d’être préparées en prenant le temps nécessaire, notamment avec l’ensemble des familles elles-mêmes. Les auteurs relèvent en effet qu’on ne peut ignorer, qu’on le regrette ou pas, que la mixité scolaire ne se réduit pas « à un enjeu de sectorisation » (p.81). C’est pourquoi la mixité « ne se construit pas dans l’entre-soi administratif » (p.88). En d’autres termes, il s’agit de nouer « des alliances éducatives territoriales souvent complexes » dans le cadre de processus nécessairement longs, y compris pour que les initiatives portent leurs fruits(p.89).
Pour autant, Najat Vallaud-Belkacem et François Dubet ne renvoient pas le dossier à la seule gestion locale. La mixité sociale et scolaire est un enjeu national et doit s’inscrire dans le cadre d’une politique d’ensemble sans « laisser les acteurs engagés se démener seuls face à des problématiques ou des oppositions qui peuvent vite les dépasser ». Encore faudrait-il que ce ministère pût se préoccuper du temps long.
L’ouvrage ne laisse pas de côté la question de l’enseignement privé sous contrat, essentiellement l’enseignement catholique qui en représente une part écrasante, mais est de surcroît structuré: SGEC (Secrétariat général à l’enseignement catholique), directions diocésaines, établissements. Les auteurs souhaitent « l’embarquer » dans une politique de développement de la mixité scolaire alors que leur caractère séparatiste s’aggrave. Ils notent avec intérêt qu’un établissement (Redon) s’est inscrit dans un tel dispositif, mais relève que chaque strate peut successivement jouer sa propre carte de l’autonomie, ce qui explique que Redon reste un cas isolé.
Les auteurs mettent les formes sur les modalités, tant il est vrai que les solutions bureaucratiques sont en la matière peu opérantes pour quelque acteur que ce soit. En revanche, ils mentionnent le fait que ces établissements « sous contrat avec l’État » (un contrat, la Cour des comptes l’a récemment relevé, qui leur impose peu de contraintes et de transparence) pourraient voire une partie de leurs moyens affectés par une forme de bonus-malus en fonction de leur participation (ou pas) aux objectifs de réduction des inégalités par référence aux IPS. On en reviendrait au fond à la théorie des « trois corbeilles » du rapport Thélot de 2004[1] qui prévoyait une part variable (de 0 à 25%) liée « aux publics accueillis ».
On soulignera enfin un manque bien explicable. Les solutions avancées pour développer la mixité fonctionnent dans des zones géographiques où des collèges publics voisins ou relativement voisins (puisqu’il s’agit d’abord d’eux) accueillent globalement des populations différenciées. Dans des secteurs de ghettoïsation globalisée (pensons à certains groupes de communes de Seine Saint-Denis ou à une commune comme Sarcelles), cela appellerait d’autres solutions puisque les expérimentations évoquées n’y sont pas praticables. Mais en 144pages, on ne pouvait entrer à ce niveau de particularité, ce qui au demeurant démontre qu’il n’y a, sur la base d’orientations nationales volontaristes, qu’une mise en musique adaptée au « local » qui puisse être efficace.
Un livre essentiel
On ne saurait trop recommander la lecture attentive d’un livre essentiel, qui, sachant nous bousculer, va finalement au-delà d’un titre somme toute réducteur. L’enjeu de la mixité scolaire et sociale est majeur: tout au long de l’ouvrage, les auteurs rappellent que plus de mixité ne nuit pas scolaire aux « plus favorisés » ou aux meilleurs élèves, mais améliore sensiblement la situation des autres, parce qu’« elle renforce la confiance des élèves dans leurs propres capacités, notamment celle d’influer sur leur destin grâce à leurs efforts ».
Ajoutons qu’il s’agit aussi de permettre à des jeunes issus de milieux différents de se croiser et de se connaître ; alors, bien mieux que par des leçons théoriques sur le vivre-ensemble, on passera concrètement du vivre (au mieux) côte à côte à faire société, autrement dit faire République, ce qui demeure une belle ambition politique, au sens le plus noble du terme, en évoquant, loin des discours de café du commerce sur l’uniforme à l’École, la réalité des questions dérangeantes et la construction des réponses qu’il leur faut apporter.
Luc Bentz
Voir aussi dans ce blog «Mixité sociale et scolaire, un choix de société» (recension du livre de Yannick Trigance).
[1] Voir le rapport Thélot sur le site viepublique.fr: https://tinyurl.com/thelot2004.
