Note de lecture publiée dans L’Ours n°538, novembre-décembre 2024.
Yannick Trigance, Mixité sociale et scolaire. Quels leviers pour quel projet ?, coll. «La petite boîte à outils», fondation Jean-Jaurès/éd. de L’aube, août 2024, 89 p., 8,90 €
Secrétaire national du Parti socialiste à l’éducation, Yannick Trigance apporte dans cet ouvrage le très heureux prolongement, au cœur de son engagement politique et professionnel d’enseignant du «9-3». L’intérêt de son approche n’est pas de proposer une vaine revanche de la bataille scolaire de 1984, mais de poser les termes du débat d’aujourd’hui, en fonction des éléments d’analyse favorables ou défavorables à son projet, des contraintes – y compris constitutionnelles qu’il s’agit d’assumer – , mais aussi des enjeux pour l’avenir qui fondent sa réflexion.
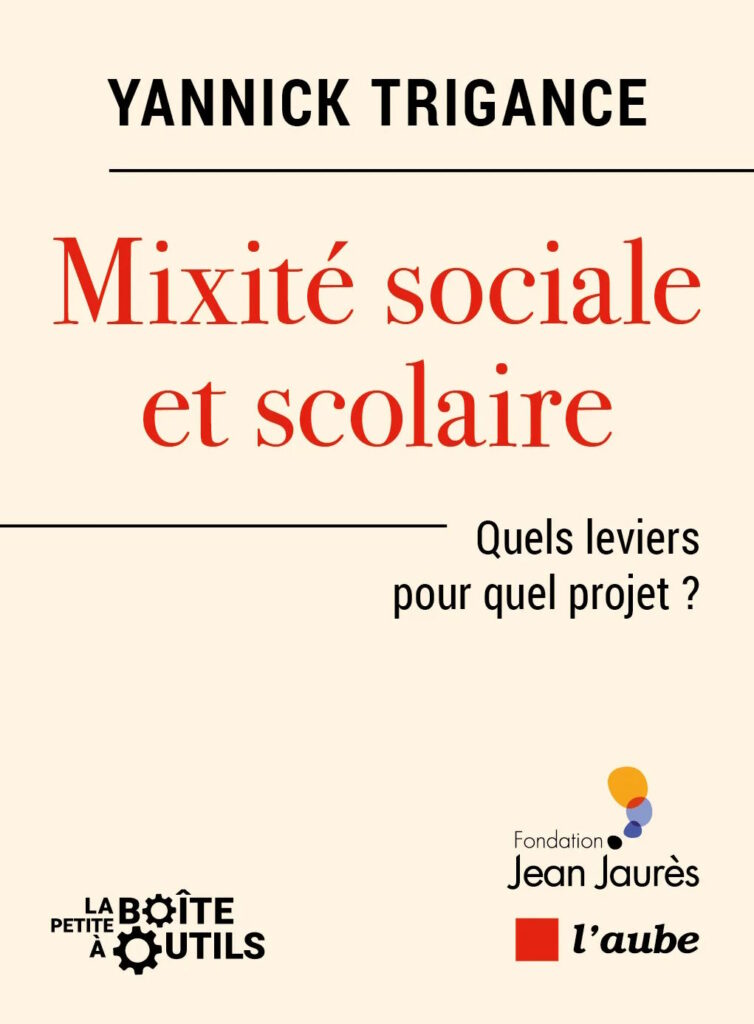
La gauche a été longuement, durablement, profondément tétanisée par l’échec du projet Savary de Grand Service public unifié de l’Éducation nationale en 1984, au point – malgré l’incontestable succès de la manifestation massive du 16 janvier 1994, dix ans après[1] – de ne remettre en cause aucun des reculs ultérieurs comme la loi Carle de 2009[2]. À l’évidence, cette question, complexe à gauche[3], a buté sur l’approche «laïque», traditionnelle depuis la Troisième République, voire le discours de Victor Hugo sur la loi Falloux en 1850; elle a resurgi avec la publication, en octobre 2022, des «indices de position sociale» (IPS) des collèges publics et privés[4]. La question mise en avant est celle de la mixité sociale et scolaire, ce qui correspond d’ailleurs plus à l’évolution d’un enseignement privé qui, s’il reste très majoritairement catholique dans l’affichage, est de moins en moins marqué par un choix confessionnel[5] et, de plus en plus, la résultante d’un séparatisme aux facettes elles-mêmes diverses[6].
Cette approche était déjà présente dans l’ouvrage récent de François Dubet et Najat Vallaud Belkacem dont nous avons rendu compte ici-même[7]. Yannick Trigance lui apporte ici le très heureux prolongement, au cœur de son engagement politique et professionnel d’enseignant du «9-3», qu’on pouvait attendre du secrétaire national du Parti socialiste à l’Éducation. S’il est évidemment militant, l’ouvrage n’est ni sommaire ni simpliste. Dans le volume contraint de cette intéressante collection coproduite par la fondation Jean-Jaurès et les éditions de L’aube, il cite très précisément ses sources (dont celle que nous venons d’évoquer), notamment scientifiques, et ne manque pas de s’interroger sur les limites d’une démarche qui ne viendrait que «d’en haut», fût-elle animée des meilleures intentions du monde. L’intérêt de son approche n’est pas de proposer une vaine revanche sur 1984, mais de poser les termes du débat d’aujourd’hui en fonction des éléments d’analyse favorables ou défavorables à son projet, des contraintes – y compris constitutionnelles qu’il s’agit d’assumer – , mais aussi des enjeux pour l’avenir qui fondent sa réflexion.

Le livre contient, après une introduction de six pages, deux parties inégales par leur ampleur. La première, en douze pages, traite de la problématique de la mixité (sociale et scolaire) comme choix de société. La seconde, sur une cinquantaine de pages, revient sur ces «leviers» évoqués déjà dans le sous-titre de l’ouvrage. On reste bien dans la dimension «boîte à outils» de la collection.
L’auteur rappelle les dangers de fracturation résultant de l’archipélisation de la société française (J.Fourquet). Il rappelle à la fois les travaux internationaux à partir des enquêtes PISA, mais aussi comment a été détricotée l’ambition portée par la loi Peillon de «viser à la mixité sociale des publics scolarisés»[8], en dépit des mesures engagées lors du passage de Najat Vallaud-Belkacem rue de Grenelle qu’il rappelle en détail. Il souligne également l’intérêt, tant sur le fond que sur la méthode, de ce qui a été mis en place, avec un accompagnement scientifique, sur l’initiative du conseil départemental de la Haute-Garonne au niveau des collèges, dans une logique de délibération, longue et approfondie, avec toutes les parties prenantes et en particulier les parents d’élèves (p.57 et suiv.).
On est là au rebours des mesures limitées à l’efficacité limitée comme l’ont été les «internats d’excellence», ou contreproductifs comme les «groupes de niveaux». En exfiltrant les «exceptions consolantes» (F. Buisson) vers les premiers, on a renforcé le sentiment de relégation de ceux qui restaient là. Les seconds, comme d’autres dispositifs conduisant à des logiques différentialistes, socialement marquées, à l’intérieur des établissements, ont pu produire les mêmes effets aux laissés pour compte. Le lecteur peut mieux s’expliquer, à défaut de le comprendre, comment les établissements scolaires ont été la cible des émeutiers de banlieue en 2023 contre le symbole même de la rupture de promesse émancipatrice de la République. Or, de la volonté de «faire République», autrement dit de faire réellement de la public un commun, il est question, transversalement, tout au long de l’ouvrage.
Cela passe par une volonté politique, au rebours finalement d’une politique blanquéro-compatible, conduite avec constance et détermination depuis 2017, où «laïcité» n’est employé que pour stigmatiser les musulmans en occultant, derrière les coups de menton sur «l’exigence», le «choc des savoirs» ou «le niveau», toute politique visant à réduire structurellement les inégalités, en commencement par le financement dont l’enseignement privé n’est jamais avare[9]. Il revient à cet égard sur les sévères observations de la Cour des comptes (L’enseignement privé sous contrat, 2023), mais aussi sur les réponses plus contraignantes en matière de financement préconisées pour prendre en compte la dimension de mixité sociale et scolaire: proposition de loi de Pierre Ouzoulias (sénateur PCF) en 2023; propositions de loi des sénateurs et des députés socialistes (mars 2024). S’il évoque par ailleurs le rapport Thélot de 2004, cette thématique y est déjà présente et, tant pour les établissements publics que privés, évoque une «troisième corbeille» de financement visant à favoriser la mixité sociale et le soutien des élèves les plus défavorisés[10].
Cette volonté politique, au-delà du financement, doit reposer sur une politique d’ensemble. Citant Philippe Watrelot, il rappelle qu’«une accumulation de dispositifs ne fait pas une politique éducative cohérente» (p.49). Il en est de même lorsque les actions sont limitées aux initiatives locales, comme le rappelle Choukri Ben Ayed (p.50). Une politique nationale est en outre nécessairement interministérielle. Cela n’exclut pas de viser à rendre plus attractive l’offre éducative des établissements ségrégués socialement, «à condition que cela ne conduise par à la ségrégation intra-établissement» (p.72).
Cela impliquerait aussi que l’Éducation nationale — outre la reconstruction d’une véritable formation des enseignants et personnels d’éducation tout au long de la vie — sache passer de la gestion bureaucratique des moyens à ce que nous appellerons une véritable gestion humaine des ressources, preuve s’il en est que le démantèlement du contrôle paritaire dans la gestion des fonctionnaires (loi Darmanin-Dussopt de 2019) n’a eu strictement aucun effet sur cet enjeu.
Une politique de mixité sociale doit être globale, et de long terme. Elle nécessite également la volonté de rééquilibrer les territoires (application de la loi SRU, mais aussi rénovation, accès à la propriété et construction de logements locatifs dans les communes où se concentre l’habitat social: voir p. 75).
Au-delà de ses indispensables aspects techniques, le livre de Yannick Trigance traduit un projet politique fort (p.78): «mettre un terme à cette situation incroyablement scandaleuse qui amène des générations d’élèves à grandir dans le même pays sans jamais côtoyer les bancs d’une même école, sans se rencontrer véritablement et donc à devenir des adultes totalement étrangers à l’altérité, pourtant pierre angulaire de notre ciment républicain».
Luc Bentz
P. S. — Je signale également ici cette recension de mon ami Christian Séranot sur le blog de la section socialiste de Sarcelles : «Faire École ensemble: la mixité, levier de justice sociale» https://tinyurl.com/Seranot-Trigance.
Voir aussi dans ce blog «Faire société à l’école pour faire République» (recension du livre de François Dubet et Najat Vallaud-Belkacem).
[1] Cette manifestation faisait suite à la loi dite Bourg-Broc, sous le ministère Bayrou, qui ouvrait les vannes au financement de l’enseignement privé par les collectivités, loi censurée de fait par le Conseil constitutionnel quelques jours auparavant.
[2] Loi 2009-1312 du 28 octobre 2009 étendant l’obligation de financement des communes à la scolarisation hors commune dans des classes élémentaires d’écoles privées sous contrat hors commune.
[3] Nous renvoyons à l’ouvrage de référence qu’est Les gauches de gouvernement et l’École, Ismaïl Ferhat (dir.), PUR, 2019.
[4] Cette publication résulte d’une condamnation du ministère de l’Éducation nationale par le tribunal administratif de Paris à la suite du recours d’un journaliste de la Gazette des communes qui s’était heurté antérieurement à des refus de la CADA.
[5] Le choix confessionnel reste la motivation du choix de l’enseignement privé israélite (qui compte néanmoins des réseaux d’établissements « élitistes ») ou musulman, le premier étant minoritaire et le second, de fait, infinitésimal.
[6] Entre le collège Stanislas – qui a défrayé la chronique pour diverses raisons, et pas seulement les propos de l’ex-ministre de l’Éducation nationale Amélie Oudéa-Castera – et l’établissement de ville moyenne ou de banlieue, la volonté de « distinction » ou de séparation est la même, les publics et les intentions de long terme sont loin d’être comparables.
[7] Le Ghetto scolaire. Pour en finir avec le séparatisme, Seuil, « La République des idées », 2024 (L’ours 535, p. 6).
[8] Actuel art. L111-1 du Code de l’éducation.
[9] Yannick Trigance cite à ce propos (p. 43) la formule du Comité national d’action laïque (CNAL) évoquant cette approche constante de l’enseignement privé catholique : «L’argent tout de suite, les objectifs plus tard, la contrainte jamais».
[10] «Pour la réussite de tous les élèves: rapport de la Commission du débat national sur l’avenir de l’École», présidée par Claude Théolot (2004). La « troisième corbeille » pouvait aller de 0 à 25 % (p. 101 du rapport). Voir : https://lstu.fr/thelot.
