Note de lecture publiée dans L’Ours n°533, janvier-février 2024.
Philippe Meirieu, Qui veut encore des professeurs ? Seuil, «Libelle», 60 p., 4,90€
Ouvrage court, mais dense ; dense, mais très agréablement écrit, et qui pose très clairement les enjeux d’une profession en cours de technicisation.
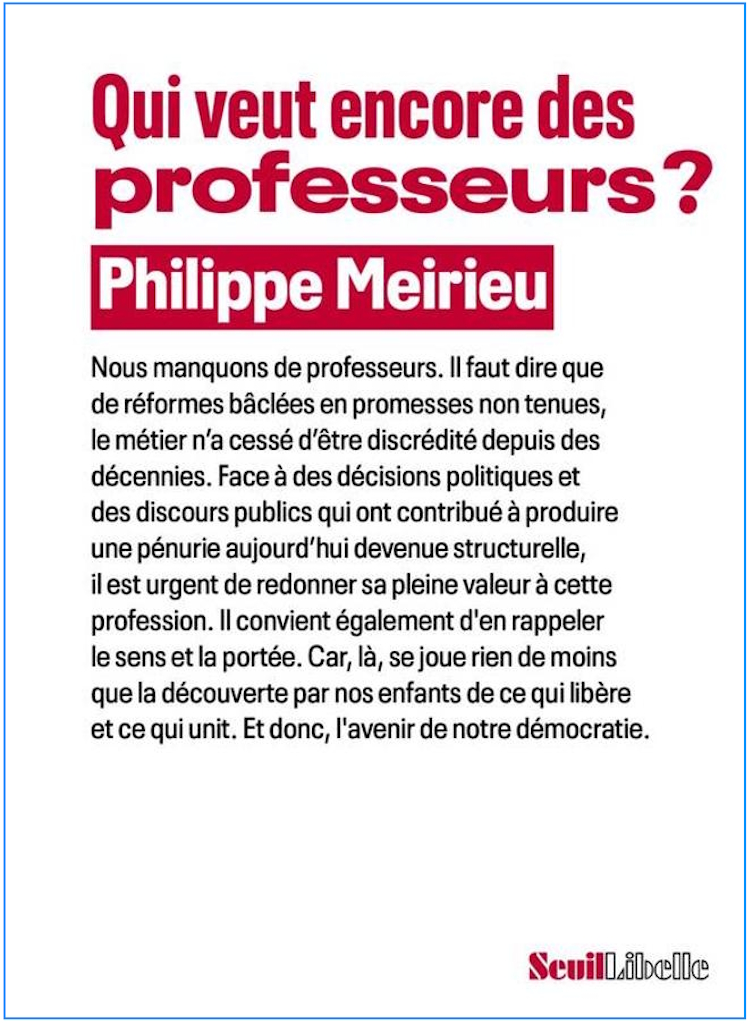
Reprenant une formule de Georges Gusdorf vieille de six décennies[1], Philippe Meirieu reprend à son compte l’idée que le professeur n’est en rien «le répétiteur d’une vérité toute faite» et qu’il n’y aurait qu’à transmettre passivement. Régulièrement poursuivi par la haine de conservateurs de tout poil qui l’ont rarement, sinon jamais lus, il est supposé incarner à leurs yeux toutes les dérives « pédagogistes ». Cet universitaire, passé par tous les degrés de l’enseignement, réaffirme pourtant ce qui est le cœur du métier, sa dialectique particulière : «Ce qu’un professeur transmet, et que les machines les plus sophistiquées ne pourront jamais faire, ce n’est pas seulement un savoir, c’est un rapport au savoir» (p. 36).
Or l’École avec un grand É est confrontée à une œuvre de technicisation, singulièrement accélérée depuis le ministère Blanquer, où l’on prône officiellement l’autonomie des acteurs et des équipes, mais sous les Fourches caudines d’évaluations massives et répétées, d’enquêtes internationales et de supposés scientistes[2]. Sur ce point, Philippe Meirieu démonte l’illusion des «bonnes pratiques», traduites par l’imposition contraignante de méthodes systématisées. La démonstration par l’absurde en a été hélas! assénée lors des confinements dus à la covid: les enseignements parcellaires par capsules vidéos ou téléchargement de fiches, sans interactions avec le professeur et les autres élèves, ont accentué les inégalités et accru les difficultés des plus fragiles.
Il met cette évolution en parallèle avec les dérives néolibérales et consuméristes que subit l’institution éducative avec une marchandisation de l’École jusqu’à l’absurde (officines proposant aux enseignants des préparations aux évaluations nationales, dérive que le Royaume-Uni a déjà connue). Il souligne au passage qu’elles font perdre de précieuses heures d’enseignement à tous les élèves quand leurs résultats pourraient être obtenus sur des échantillons restreints. Mais cela procède d’une gouvernance verticale assez dans l’air du temps.
Philippe Meirieu, dans la partie finale de l’ouvrage, insiste sur ce que devrait être le rôle de l’École, qui n’est pas seulement d’apprendre (en quoi il rejoint Ferry et Buisson), mais de viser, au-delà d’un «vivre ensemble» qui n’exclut pas l’indifférence, à «faire ensemble société . Le rôle du professeur y reste «décisif» comme garant de «l’exigence de rigueur et de vérité» (p. 40) où il s’agit «d’instruire sans enfermer, de transmettre sans clôturer» (p.52). Un ouvrage indispensable, donc, à qui s’intéresse aux questions éducatives.
Luc Bentz
[1] Georges Gusdorf, Pourquoi des professeurs ? Payot, 1963
[2] La focalisation sur l’apprentissage syllabique, sous l’influence des neurosciences, n’a pas, tant s’en faut, réglé les problèmes de compréhension en lecture au-delà même du cours préparatoire.
